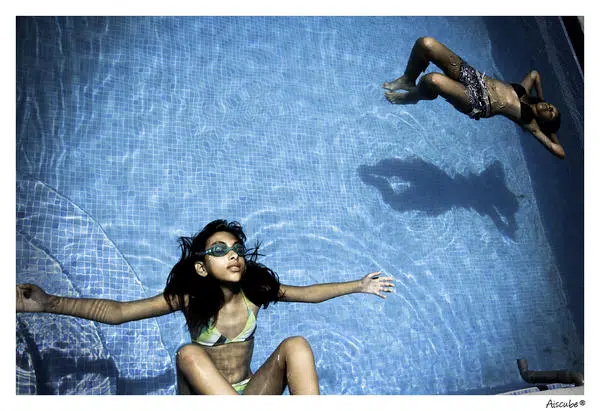En France, les formulaires administratifs imposent souvent un choix binaire : Madame ou Monsieur. Certaines institutions acceptent désormais des formulations neutres ou personnalisées, mais leur adoption reste marginale.
Des erreurs fréquentes persistent dans l’usage des titres et des pronoms, malgré des recommandations officielles sur la prise en compte des identités de genre. Des personnes témoignent d’un malaise persistant lorsque leurs demandes de respect ne sont pas entendues.
Comprendre la non-binarité : au-delà du féminin et du masculin
Le genre ne s’arrête pas à la case homme ou femme. Il existe tout un éventail d’identités, dont celle de non-binaire : une réalité vécue au quotidien par de nombreuses personnes, ni strictement masculines, ni purement féminines. Longtemps ignorée, cette pluralité remet en question l’organisation binaire de notre société, appelle à bousculer les usages, les cadres juridiques et les réflexes culturels.
En France, la plupart des textes officiels, formulaires et démarches administratives s’appuient toujours sur la distinction « homme/femme ». Mais le genre assigné à la naissance ne correspond pas toujours à ce que chacun ressent et exprime. Ce décalage, parfois douloureux, alimente discriminations et incompréhensions, que l’on soit non-binaire, trans ou intersexe.
Reconnaître la non-binarité, c’est accepter que l’identité de genre se déploie sur un spectre multiple. Le principe de genre neutre, discuté depuis longtemps au Canada, en Amérique du Nord ou en Australie, commence à trouver écho dans les débats français. Pourtant, le code civil ne prévoit aucun espace pour des identités qui sortent du schéma traditionnel. Les associations LGBT réclament une évolution profonde des textes et des pratiques, afin que chacun puisse exister sans se heurter à des catégories restrictives.
Pour mieux saisir la diversité de ces notions, voici quelques repères :
- Identité de genre : ressenti intime d’appartenir à un genre, ou à aucun.
- Genre binaire : système qui divise les individus entre homme et femme.
- Expression de genre : façon de se présenter à travers le prénom, les vêtements, la manière de parler.
Qu’il s’agisse de démarches administratives ou de scènes du quotidien, la reconnaissance des identités non-binaires interroge nos fondements et le respect dû à chacun.
Quels termes et pronoms utiliser pour parler avec respect à une personne non binaire ?
Choisir les bons mots, ce n’est pas un simple code de politesse. En français, la question des pronoms devient vite un casse-tête, coincée entre le masculin et le féminin. Pourtant, des alternatives existent et se diffusent, notamment dans les milieux militants ou associatifs. Le pronom « iel », issu de la fusion entre « il » et « elle », s’invite dans les conversations, mais suscite parfois débats et réticences. D’autres formes comme « ael » ou « ul » circulent, portées par la volonté d’incarner toutes les nuances du genre.
Il n’existe pas de règle universelle pour choisir un pronom. Le plus simple est encore de demander à la personne : certains préfèrent alterner, d’autres optent pour un neutre constant. L’écriture inclusive tente d’apporter des solutions, notamment dans les institutions. En Ontario, la fonction publique a mis en place une case « autre » et la mention « Mx » sur certains documents. Au Québec, la Banque de dépannage linguistique conseille de bannir les formules genrées quand l’information manque.
Voici quelques repères pour s’adresser à une personne non binaire :
- Respecter le choix du pronom : iel, ils, elles, ael ou prénom.
- Privilégier la neutralité dans les échanges écrits et oraux : prénom, Mx, titre non genré.
- Adapter les accords au singulier ou au pluriel, selon ce que la personne souhaite.
La langue française n’a pas encore tranché la question des accords des adjectifs ou participes passés au neutre. Certains utilisent le point médian, d’autres la double flexion, certains encore maintiennent le masculin, souvent vécu comme une négation de soi. Ces hésitations révèlent à la fois les limites du système actuel et une évolution profonde, motivée par l’exigence d’un respect langagier pour toutes les identités.
Madame, Monsieur… et après ? Les alternatives pour une communication inclusive
La formule « Madame, Monsieur » continue de s’imposer dans les courriers, les guichets, les annonces. Mais l’invisibilisation des personnes non binaires pousse à réinventer ces usages. À la SNCF, le choix a été fait de remplacer « Mesdames, Messieurs » par « chers voyageurs » dans les annonces des trains, salué par les collectifs LGBT et les défenseurs des droits des personnes.
Dans le secteur public, de nouveaux réflexes se mettent lentement en place. Radio-Canada suggère d’utiliser le prénom ou des formules neutres, comme « bonjour à toutes et à tous », voire « bonjour à toutes, tous et toutes ». À Ottawa, l’administration introduit la mention Mx sur certains formulaires. La Banque de dépannage linguistique recommande d’abandonner les titres genrés pour instaurer une communication respectueuse et adaptée.
Voici quelques alternatives concrètes à intégrer dans les échanges :
- Utiliser le prénom plutôt qu’un titre lors d’un contact direct.
- Recourir à des formules collectives : « bienvenue à toutes et tous ».
- Choisir un titre neutre quand c’est possible : Mx, collègue, membre, personne.
À Paris, Toulouse ou ailleurs, des collectifs proposent des guides pratiques pour adapter la communication professionnelle et institutionnelle. Cette transition linguistique, portée par une demande croissante de reconnaissance, oblige entreprises et administrations à revoir leurs habitudes, pour ne plus écarter personne. La langue, loin d’être figée, évolue sous la pression de la société et du souci de justice.
Favoriser la compréhension et le respect des identités non binaires au quotidien
Reconnaître les identités non binaires devient un enjeu de société, qui dépasse le seul engagement militant. À l’hôpital, dans l’université ou l’entreprise, il s’agit d’améliorer l’accueil, de garantir le droit à la vie privée et l’accès aux services publics sans obstacle. Au Canada, la Colombie-Britannique autorise désormais l’inscription d’un genre « X » sur les papiers officiels, offrant une réponse concrète aux personnes qui ne se reconnaissent pas dans les catégories traditionnelles.
À New York, les hôpitaux ont l’obligation de proposer des formulaires qui distinguent l’identité de genre du sexe assigné à la naissance. Cette avancée, saluée par les associations de défense des droits et libertés, limite les maladresses qui peuvent mener à l’exclusion ou à la discrimination. En France, ce modèle n’est pas généralisé, mais le débat est lancé sur la modification du code des droits de la personne et de la charte des droits et libertés.
Pour faire évoluer les pratiques, plusieurs actions concrètes peuvent être déployées :
- Mettre en place des formations à la diversité des genres pour les agents publics
- Afficher des guides sur le respect des identités et expressions de genre dans les lieux d’accueil
- Adapter les logiciels administratifs pour inclure les mentions non binaires
L’exemple du Pakistan, qui reconnaît officiellement un troisième genre depuis 2009, prouve l’impact de mesures juridiques concrètes sur la réduction des discriminations et l’accès aux droits. Selon le Williams Institute, une meilleure prise en compte des identités non binaires contribue à la santé mentale et facilite le recours aux soins pour celles et ceux longtemps ignorés par les institutions. Ce mouvement, timide ou affirmé selon les pays, esquisse la société de demain : plus attentive, plus juste, où chaque personne peut enfin se présenter telle qu’elle est.